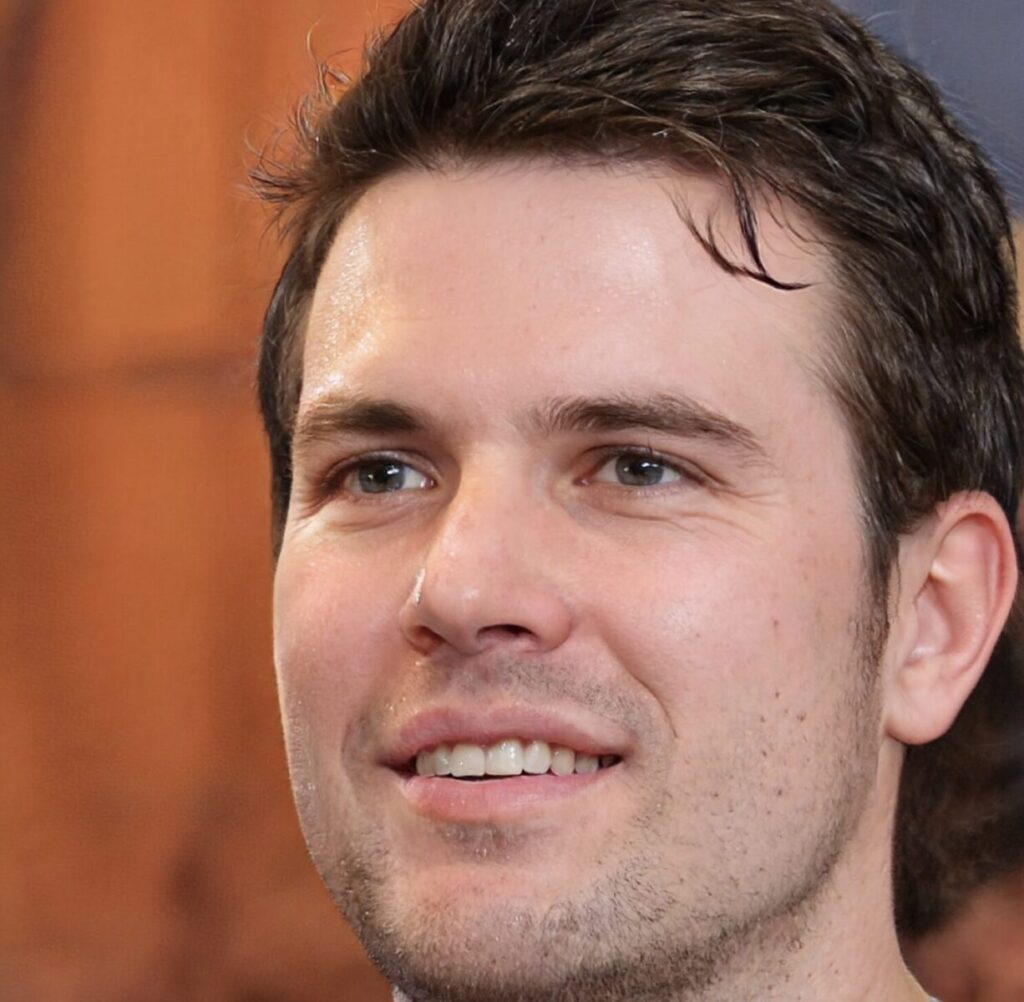L’investissement responsable connaît un essor remarquable en Europe, avec plus de 2 000 fonds durables qui administrent aujourd’hui plus de 1 307 milliards d’euros. Ces données témoignent d’une véritable transformation de l’industrie financière. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont entre désormais en ligne de compte. Derrière ces montants impressionnants évoluent des acteurs qui dessinent l’avenir de la finance responsable. Voyons ensemble les méthodes et les instruments que ces professionnels déploient pour allier rendement et éthique.
Les grands noms de la gestion éthique : quelles stratégies utilisent-ils pour éviter les secteurs controversés ?
Les gestionnaires de fonds éthiques pratiquent des politiques d’exclusion strictes. Ils refusent de placer l’argent de leurs clients dans les secteurs controversés, comme :
- les énergies fossiles,
- l’armement,
- le tabac,
- l’alcool.
Ils répondent ainsi à la demande des investisseurs qui ne veulent pas financer des activités qu’ils désapprouvent moralement. Ils anticipent aussi les futures réglementations qui toucheront ces secteurs (taxe carbone, interdictions).
Les exclusions ne se limitent pas aux activités. Certaines structures préfèrent bannir des pratiques qu’elles jugent abusives plutôt que des industries entières. C’est le cas de lina.finance, qui exclut totalement le riba (intérêts) de ses recommandations d’investissement. Cette startup s’inspire des principes de la finance islamique. Son approche va plus loin que les critères ESG classiques, puisqu’elle rejette la base même du système bancaire traditionnel, c’est-à-dire la rémunération du capital par l’intérêt.
Une autre stratégie consiste à accepter les entreprises les plus vertueuses indépendamment de leur secteur. Cette méthode dite « best in class » est moins radicale. Les gestionnaires sélectionnent simplement les sociétés ayant les meilleurs scores ESG dans leur domaine d’activité. Un fonds peut ainsi détenir TotalEnergies au lieu d’ExxonMobil si le groupe français démontre de meilleures performances environnementales.
Comment évaluer la performance d’un fonds éthique sur le long terme ?
Mesurer la rentabilité des fonds éthiques demande d’aller plus loin que les simples chiffres financiers. Les études récentes sont encourageantes. Elles montrent que les entreprises durables génèrent de meilleurs rendements. Cette tendance s’explique par une analyse plus fine qui révèle des opportunités de croissance souvent ignorées par les méthodes classiques.
Les gestionnaires ISR scrutent les critères ESG pour repérer les risques cachés. Cette approche capture mieux les dangers réglementaires et de réputation. L’affaire Volkswagen l’illustre parfaitement. La plupart des fonds ISR avaient évité ce titre grâce au repérage précoce de problèmes de gouvernance, notamment l’absence de contre-pouvoirs au conseil d’administration.
La performance à long terme s’apprécie aussi par la capacité à traverser les crises tout en gardant ses objectifs durables. En 2022, les fonds durables ont certes chuté de 14,09 % à cause de leur faible exposition aux énergies fossiles, mais ils ont rebondi de 13,52 % début 2023. Cette volatilité temporaire cache souvent une solidité supérieure sur la durée.
Quels outils pour suivre la transparence et la conformité des fonds éthiques ?
Un arsenal réglementaire de plus en plus sophistiqué encadre désormais les fonds éthiques. Le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) classe les fonds en trois catégories :
- l’article 6 pour les fonds classiques,
- l’article 8 pour ceux qui intègrent des critères ESG,
- l’article 9 pour ceux ayant un véritable objectif durable.
Cette classification aide les épargnants à identifier le niveau d’engagement réel des produits. Trois labels nationaux renforcent ces garanties. Le label ISR français supervise des milliards d’euros et impose l’exclusion de 20 % des entreprises les moins bien notées sur les critères ESG. Il exige aussi un rapport détaillé sur les impacts environnementaux et sociaux. Le label Greenfin bannit totalement le nucléaire et les énergies fossiles. Le label Finansol privilégie la solidarité et l’économie sociale. Des organismes indépendants vérifient régulièrement le respect de ces critères.
De nouvelles règles de surveillance entrent en vigueur dès 2025. L’Autorité des marchés financiers (AMF) durcit ses exigences. Les gestionnaires doivent fournir des rapports précis sur leurs critères ESG et leurs méthodes d’évaluation. Ils doivent aussi prouver que leurs placements respectent la taxonomie européenne. Ces évolutions combattent l’écoblanchiment et garantissent aux épargnants une information fiable.